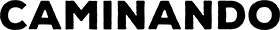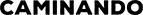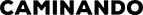Lorsque terre rime avec vie : la perspective des femmes sur la question des terres et des eaux au Guatemala
28 juillet 2019
Doña Crisanta Pérez, le combat de la fourmi contre l’éléphant
30 juillet 2019Raquel Neyra
Raquel Neyra est une activiste contre le projet minier Conga, à Cajamarca. Elle a porté le cas Conga auprès du Haut-Commissariat des droits humains des Nations Unies, à Genève dans plusieurs sessions entre 2012 et 2015. Actuellement, elle est activiste dans la défense de l’environnement et la lutte pour l’eau au Pérou, membre du collectif Alternatives au développement extractiviste et anthropocentré (ADEAH), et communicatrice pour SERVINDI (média autochtone) et diverses autres médias. Elle offre des formations aux ronderos en souveraineté alimentaire. Elle détient un diplôme en économie agraire de l’Université Agraria La Molina, Lima, Pérou, ainsi qu’une maîtrise en commerce international et un MBA de La Sorbonne, à Paris.