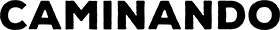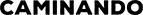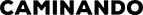Frontière ce n’est pas juste un mot
14 juin 2022
Le Venezuela est le pays d’Amérique latine avec le plus d’émigration en 2019
14 juin 2022Félix Molina
FÉLIX MOLINA est journaliste, fondateur de l’Association de médias communautaires du Honduras (Asociación de Medios Comunitarios de Honduras, AMCH), survivant de deux attaques à main armée le 2 mai 2016 à Tegucigalpa, la capitale du Honduras, conséquence de son travail critique et indépendant dans un des pays les plus dangereux au monde pour les travailleurs et travailleuses de la presse. Il a reçu le Prix Chavking a la Integridad Periodística Iberoamericana en 2012 pour avoir dirigé l’émission de radio Resistencias suite au coup d’État de 2009 et est actuellement reconnu comme personne protégée au Canada selon le Statut de l’Office du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugié.e.s.