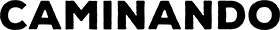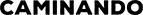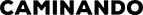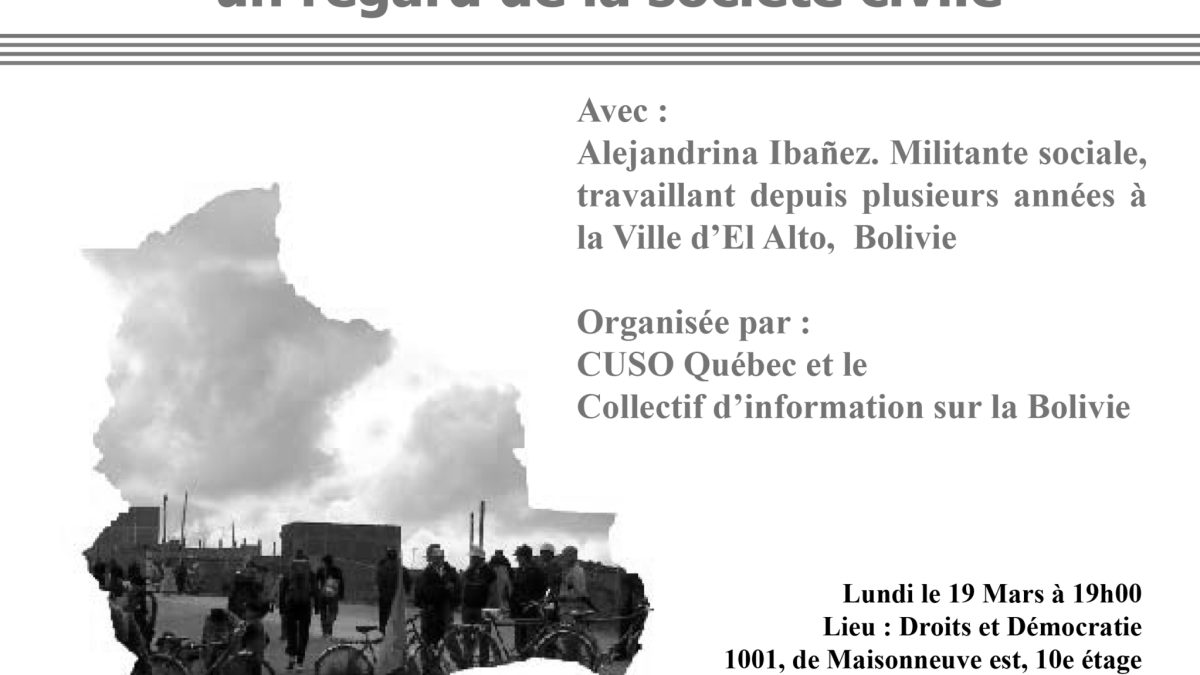Le Comité chilien pour les droits humains
8 mars 2019
Les jumeaux boréal et austral des Amériques: Les «Printemps» chilien (2011) et québécois (2012) dans une perspective historique de solidarité
8 mars 2019Ana María Seifert
Ana María Seifert est fondatrice du CSPB en 1974. Elle a travaillé durant plus de 15 ans en recherche universitaire dans le domaine de la santé au travail, plus spécifiquement pour les femmes. Depuis 4 ans, elle est conseillère syndicale en santé et sécurité au travail à la CSN.
Jaime del Carpio Zuazo
Jaime del Carpio Zuazo s’engage avec le CSPB dans les années 1980. Il œuvre en coopération internationale depuis plus de 30 ans (Jeunesse Canada Monde, l’OCSD et OXFAM-Québec). Actuellement, il est gestionnaire de programmes pour l’Amérique latine à l’Œuvre Léger.
Gustavo Saavedra
Gustavo Saavedra est activiste social et fondateur de l’Atelier de Musique Arawi (La Paz, 1981). Dès son arrivée à Montréal en 1985, il s’engage avec le Comité et poursuit ses études en biologie. Sa voix et sa guitare ont fait entendre la voix des peuples, leurs espoirs et leurs peines.