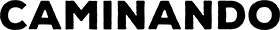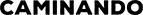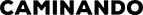Des femmes autochtones et paysannes résistent au développement des mégaprojets hydroélectriques en Bolivie : une histoire encore peu connue
27 février 2020Trop comme pas assez / Ta mère te parle
27 février 2020Movimiento Autónomo de Mujeres
Le Mouvement autonome des femmes (Movimiento Autónomo de Mujeres) du Nicaragua est un mouvement social et politique autonome qui revendique l’égalité, la liberté et la solidarité pour la construction d’un système politique, économique et social incluant une démocratie paritaire. Il lutte contre l’autoritarisme patriarcal sous toutes ses formes pour transformer les relations de pouvoir inégales et pour l’instauration d’un État de droit comme condition préalable à la construction d’une société fondée sur la justice sociale, économique, politique et culturelle.
Unión Latinoamericana de Mujeres
L’Union latino-américaine des femmes (Unión Latinoamericana de Mujeres, ULAM) est un réseau régional composé de groupes et d’organisations dirigées par des femmes pour le bénéfice des femmes d’origine rurale et autochtone affectées socialement, culturellement et économiquement, par les pratiques et les politiques minières.