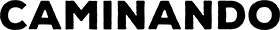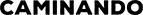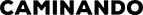(Re)configuration patriarcale des territoires : mégaprojets extractifs et lutte des femmes en Amérique latine
26 février 2020
Berta Cáceres n’est pas morte, elle s’est multipliée! Hommage à une vie de résistance aux barrages, aux mines et au capitalisme
26 février 2020Carla Christina Ayala Alcayaga
Carla Christina Ayala Alcayaga est responsable de projet d’éducation du public au sein du CDHAL depuis 2016. Elle a assumé un rôle de co-coordination de la rencontre internationale « Femmes en résistance face à l’extractivisme ». Elle s’implique au CDHAL depuis 2015, où elle a notamment coordonné les projets d’éducation du public « 40 ans de luttes pour la défense des droits humains en Amérique latine et au Québec » et « Luttes pour la défense des territoires : résistances et solidarités féministes face à l’extractivisme ».
Marie-Ève Marleau
Marie-Eve Marleau est agente administrative pour le Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL) et pour Katalizo et expérimente des projets d’agroécologie dans les Cantons de l’Est. Au cours des 15 dernières années, elle a collaboré à plusieurs reprises avec la Coalition Québec meilleure mine, alors professionnelle de recherche au Centre de recherche en éducation relative à l’environnement et à l’écocitoyenneté de l’UQAM et ensuite coordonnatrice du CDHAL.
Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL)
Le Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL) est une organisation de solidarité qui travaille à la défense et à la promotion des droits humains en réciprocité avec les mouvements sociaux et les communautés d’Amérique latine dans la lutte en faveur d’une justice sociale, environnementale, économique et culturelle.