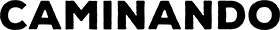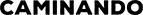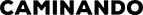Éditorial
6 décembre 2019
Retour sur la rencontre internationale « Femmes en résistance face à l’extractivisme »
26 février 2020Collectif Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo
Nous, le Collectif Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo, sommes des activistes enthousiastes, énergiques, qui croient à la transformation et au pouvoir qui réside dans le fait de penser la vie collectivement. Nées dans différents pays (Équateur, Mexique, Espagne, Brésil, Uruguay), nous nous sommes rencontrées il y a cinq ans à Quito, ville qui est devenue le lieu de nos conspirations. Le féminisme latinoaméricain et caribéen est notre espace de lutte, d’invention, de création, de transformation et de réflexion. À travers nos regards, nous tissons des liens entre les corps, dans leur diversité, et les territoires. www.territorioyfeminismos.org