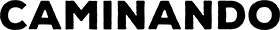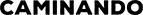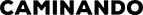Les migrant∙e∙s s’organisent à travers le Canada : Entrevue avec Marco Luciano de Migrante Alberta
18 juin 2022
Éducation populaire et femmes migrantes : contribution à partir d’une expérience à Mendoza, en Argentine
18 juin 2022Judith Cruz Sánchez
Judith Cruz Sánchez est actuellement présidente, représentante légale et responsable de l’axe de l’éducation et animatrice à La Otra Cooperativa. En tant que femme, elle se définit comme une défenseure des droits des femmes, des filles et des jeunes. Elle a participé à plusieurs campagnes de communication afin de mettre de l’avant les demandes des populations victimes de violences et de criminalisation pour le simple fait de défendre la vie, l’eau et la terre.
Alexi Utrera
Alexi Utrera est une journaliste indépendante qui a étudié la communication sociale et le journalisme à l’Université autonome de Colombie. Elle a terminé ses études avec un diplôme en sciences cinématographiques de l’Université Ryerson à Toronto et est actuellement inscrite au programme de coopération internationale à l’Université de Montréal. Exilée d’origine colombo-vénézuélienne, elle a publié des articles dans divers médias latino-américains et ontariens qui était sa première province de résidence au Canada. Au Québec depuis 2015, Alexi continue de collaborer avec des organisations de défense des droits humains en Amérique latine.
Rosa Castillo
Rosa Onelia Leonardo Castillo est actuellement responsable de l’axe de communication à La Otra Cooperativa, où elle a acquis une grande expérience de travail théorique et pratique en matière d'éducation et de communication populaire. Elle a appuyé la fondation, la formation et le fonctionnement de la radio en ligne « Un Nuevo Sol Rebelde », ainsi que la coordination et la facilitation des ateliers de la Red Mesoamericana de Radios Comunitarias, Indígenas, Garífunas y feministas de Guatemala.
Miriam Guadalupe Figueroa Vásquez
Miriam Guadalupe Figueroa Vásquez est passionnée par la radio et d’informer à travers les médias alternatifs, prendre la parole et ressentir les peuples à d'autres endroits et pays. Fille d’une famille de combattant·e·s, elle a grandi entourée par la lutte et la résistance pour la justice, pour le territoire, pour les droits humains et des peuples. Elle est actuellement responsable de la radio en ligne « Un Nuevo Sol Rebelde » et travaille pour la défense des droits humains, de la terre, du territoire, mais principalement pour les droits des femmes et des filles.