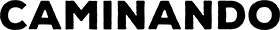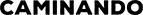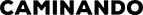Mourir en héros
4 août 2022
Solidarité avec Mamadou Konaté !
4 août 2022Carla Christina Ayala Alcayaga
Carla Christina Ayala Alcayaga est responsable de projet d’éducation du public au sein du CDHAL depuis 2016. Elle a assumé un rôle de co-coordination de la rencontre internationale « Femmes en résistance face à l’extractivisme ». Elle s’implique au CDHAL depuis 2015, où elle a notamment coordonné les projets d’éducation du public « 40 ans de luttes pour la défense des droits humains en Amérique latine et au Québec » et « Luttes pour la défense des territoires : résistances et solidarités féministes face à l’extractivisme ».
Rosalinda Hidalgo
Rosalinda Hidalgo est ethnologue ayant réalisé des études supérieures en développement rural. Elle est une activiste, de l’Assemblée de Veracruz pour les initiatives et la défense de l’environnement (LAVIDA), du Mouvement mexicain de personnes affectées par les barrages et en défense des fleuves (MAPDER) et du Mouvement de personnes affectées par les barrages d’Amérique latine. Les axes de travail auxquels elle s’intéresse sont la gestion de bassins, des forêts et de l’eau.