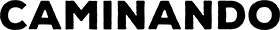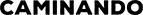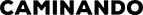Moi, Mateo Pablo, maya chuj, et l’histoire d’extrêmes violences de mon peuple, à travers celle de ma famille
23 juillet 2019
Participation dans le mouvement syndical et populaire du Salvador
23 juillet 2019Pierre Beaucage
Pierre Beaucage est professeur émérite au département d’anthropologie de l’Université de Montréal, où il a enseigné de 1970 à 2002 sur les thèmes de l’anthropologie économique, de la problématique du développement, de l’ethnologie de la Mésoamérique et des mouvements paysans et autochtones. Il a obtenu un doctorat en 1970 à la London School of Economics and Political Science. Sa thèse portait sur l’organisation économique des Garifunas du Honduras. Depuis 1970, ses recherches ont porté sur les autochtones du Mexique. En collaboration avec deux organisations nahuas, le Taller de Tradición Oral Totamachilis, et la coopérative régionale Tosepan Totataniske, il a poursuivi ses recherches conjointes sur les connaissances de la nature et le mouvement de résistance face aux entreprises minières et hydroélectriques.