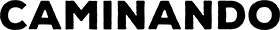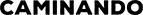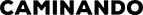Revue Caminando, vol. 40
50 ans de résistance pour les droits humains et la solidarité
Date limite pour soumettre une proposition : 13 février 2026
Date limite pour soumettre un texte : 19 mars 2026
Présentation de la revue
Caminando est une revue de réflexion et d’engagement qui diffuse depuis 1980 une information alternative sur les luttes sociales et les droits humains en Amérique latine. Caminando publie des articles portant un regard critique sur les grands enjeux qui animent la vie sociopolitique latino-américaine et sur les luttes pour la défense des droits et pour l’autodétermination menées en Amérique latine, mais aussi au Québec et au Canada. La revue publie également des récits et des poèmes, de même que des illustrations et des photographies portant sur les thématiques abordées dans chaque numéro. Caminando paraît deux fois l’an en français en format papier et numérique. Les articles sont également publiés en version électronique sur les plateformes Érudit et EBSCO. www.caminando.ca
La revue est publiée par le Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL), une organisation de solidarité qui travaille à la défense et à la promotion des droits humains en réciprocité avec les mouvements sociaux et les communautés d’Amérique latine, dans la lutte en faveur d’une justice sociale, environnementale, économique et culturelle. www.cdhal.org
Prochaine édition de Caminando
Au cours de ces cinq dernières décennies, le CDHAL s’est construit grâce au travail de nombreuses personnes et organisations qui, dans un esprit de solidarité, l’ont accompagnée et soutenue. Dans une perspective décoloniale et féministe, nous avons appuyé les luttes sociales contre les violences et coups d’État, les guerres civiles, le libre-échange et l’extractivisme, ainsi que les luttes des personnes migrantes au Canada, tout en reconnaissant et en travaillant en collaboration avec les organisations de base et en mettant au centre le rôle des personnes qui risquent leur sécurité pour défendre les territoires et les droits collectifs.
Aujourd’hui, après 50 ans, les coups d’État, les dictatures, l’interventionnisme et l’extractivisme perdurent et s’accompagnent d’un renouvellement des forces d’extrême droite qui cherchent à faire reculer les droits des femmes, des personnes de la diversité sexuelle, migrantes, travailleuses, pour n’en citer que quelques-uns. Dans ce contexte, l’organisation collective, la résistance et la défense des droits et des territoires sont urgentes, nécessaires et pertinentes. Que pouvons-nous tirer des luttes passées ? Quelles sont les nouvelles formes de solidarité et de résistance? Le volume 40 de la revue Caminando se veut un espace de dialogue de ces voix qui ont formé, à travers le temps, et forment encore aujourd’hui les bases de la résistance face aux grands enjeux des droits humains en Amérique latine. Construits sous forme de narration (storytelling) et de ressentis, les articles dans ce numéro aborderont la résistance devant les grandes tempêtes d’aujourd’hui et des cinquante dernières années.
À titre d’exemple, mais pas exclusivement, vos contributions pourraient aborder les thèmes suivants :
- Récits ou témoignages portant sur des thèmes, tels que la migration, le populisme et la polarisation, la participation citoyenne menacée, les luttes face à la montée de l’autoritarisme et du néolibéralisme, les crises environnementales, l’interventionnisme et la souveraineté;
- Le militantisme et la solidarité provenant du vécu et du ressenti;
- Les connaissances expérientielles et les connaissances situées;
- Les réflexions sur les transformations sociales qui ont marqué le passé ou favorisé l’avancement de la solidarité locale et internationale;
- Comment l’histoire a-t-elle façonné l’avenir? Comment imaginer le futur? Comment renforcer la solidarité?
Pour ces numéros, nous encourageons fortement les auteurs et autrices à utiliser des formes d’écriture se rapprochant de la narration, du témoignage, du récit et du ressenti. Nous ne publierons pas d’articles académiques ou ceux contenant des études de cas et nous encourageons fortement les personnes autrices à éviter d’utiliser des notes et des références, sauf pour expliciter brièvement leurs propos.
Types de textes
Les contributions peuvent prendre différentes formes : récits, témoignages, entretiens, poèmes, essais, entre autres.
Directives de publications
Les directives de publication sont disponibles ici.
Les personnes autrices s’engagent à lire les directives de publication et à les appliquer dans leur article.
Modalités de soumission et dates de tombée
- Si vous souhaitez contribuer au prochain numéro de Caminando, veuillez nous faire parvenir un titre provisoire et un court résumé de votre texte, dès que possible, à l’adresse suivante : caminando@cdhal.org.
- Les textes complets devront être reçus au plus tard le 19 mars 2026. Nous vous invitons toutefois à soumettre votre texte dès qu’il est prêt.
- Tous les textes doivent être soumis en format .doc, .docx ou .odt.
- Le texte doit avoir été mis en forme selon nos directives de publication.
Deux numéros sont prévus : un premier en mai 2026 et un deuxième en novembre 2026. Selon la thématique de votre article, il est possible qu’un article soumis en mars 2026 soit publié dans le numéro de novembre. Vous en serez informé·es, le cas échéant.