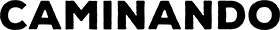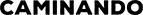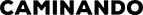Pour notre corps, pour notre terre : des femmes qui défendent la vie
1 août 2019
Un appel aux exercices de conjugaison
1 août 2019Fabienne Elodie Ekobena
Fabienne Elodie Ekobena détient un baccalauréat et une maîtrise en sciences politiques de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM). Elle travaille actuellement sur les questions de justice sociale et d’écologie en pastorale sociale à Villeray. Son intérêt sur les enjeux socio-politiques et environnementaux liés à l’extractivisme l’ont menée à se pencher sur l’aide publique de la Suisse au développement, le projet du pipeline Tchad-Cameroun et l’expansion mondiale de l’huile de palme, particulièrement au Cameroun. Elle a donné des conférences dans certains groupes de Développement et Paix et fait des animations sous forme d’éducation populaire auprès du Centre des Femmes d’Ici et d’Ailleurs.