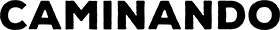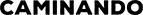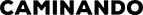Incertitude et mobilisation sur la route du Canal interocéanique du Nicaragua
1 août 2019
Il était une fois une lutte pour la vie
1 août 2019
Manifestantes sostiene carteles durante una protesta masiva frente al Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala en el centro de la ciudad de Guatemala 15 de agosto 2015. El 25 de abril del 2015, miles de personas se concentraron en el parque central para exigir la renuncia del presidente, Otto Pérez Molina, y la vicepresidenta, Roxana Baldetti, tras destaparse un escándalo de corrupción en las aduanas que involucra a altos funcionarios de gobierno. Las manifestaciones han continuado todos los sábados en la tarde frente al Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala, también se exige la reforma electoral y que se cancelen los comicios el 6 de septiembre 2015. Foto: Luis Soto
Marie-Dominik Langlois
Marie-Dominik Langlois est candidate à la maîtrise en science politique à l’Université du Québec à Montréal, étudiante membre du Groupe de recherche sur les espaces publics et innovations politiques et anciennement coordonnatrice pendant 8 ans auprès de différentes organisations de solidarité internationale en Amérique latine.