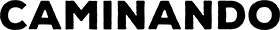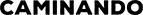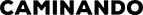Choc pandémique et capitalisme de surveillance
31 août 2022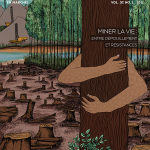
Éditorial – Miner la vie : Entre dépouillement et résistances
6 juin 2023Marie-Ève Marleau
Marie-Eve Marleau est agente administrative pour le Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL) et pour Katalizo et expérimente des projets d’agroécologie dans les Cantons de l’Est. Au cours des 15 dernières années, elle a collaboré à plusieurs reprises avec la Coalition Québec meilleure mine, alors professionnelle de recherche au Centre de recherche en éducation relative à l’environnement et à l’écocitoyenneté de l’UQAM et ensuite coordonnatrice du CDHAL.
Roselyne Gagnon
Roselyne Gagnon est titulaire d’un baccalauréat en Arts de l’Université McGill, avec concentration en études du développement international et études de l’Amérique latine et des Caraïbes. Elle est diplômée de la maîtrise en science politique de l’Université du Québec à Montréal et travaille au Comité pour les droits humains en Amérique latine.