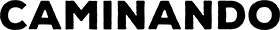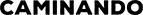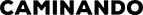Les contradictions du modèle énergétique et la violation des droits humains chez les femmes affectées par les barrages
28 juillet 2019
Extractivisme : plongée au cœur de la crise climatique
28 juillet 2019Rosalinda Hidalgo
Rosalinda Hidalgo est ethnologue ayant réalisé des études supérieures en développement rural. Elle est une activiste, de l’Assemblée de Veracruz pour les initiatives et la défense de l’environnement (LAVIDA), du Mouvement mexicain de personnes affectées par les barrages et en défense des fleuves (MAPDER) et du Mouvement de personnes affectées par les barrages d’Amérique latine. Les axes de travail auxquels elle s’intéresse sont la gestion de bassins, des forêts et de l’eau.
Luisa Paré
Luisa Paré est anthropologue et professeure de l’Institut de recherches sociales de l’Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Elle est membre de l’Assemblée de Veracruz pour les initiatives et la défense de l’environnement (LAVIDA). Elle s’intéresse aux sujets liés à la défense de l’eau et aux conflits environnementaux de l’État de Veracruz au Mexique.
Beatriz Torres Beristain
Beatriz Torres Beristain est chercheure à la Direction générale de recherche de l’Universidad Veracruzana (UV). Elle détient une maîtrise en écologie (UNAM) et un Ph.D en qualité de l’eau (Wageningen University, Pays Bas). Dans l’actualité, elle s’intéresse aux problématiques socio-environnementales. Elle est membre de l’Assemblée de Veracruz pour les initiatives et la défense de l’environnement (LAVIDA). LAVIDA est un espace pluriel de rencontres citoyennes, d’analyses, de dénonciations et d’alternatives contre la destruction de l’environnement et pour la défense des droits. Tiré du site : http://www.lavida.org.mx